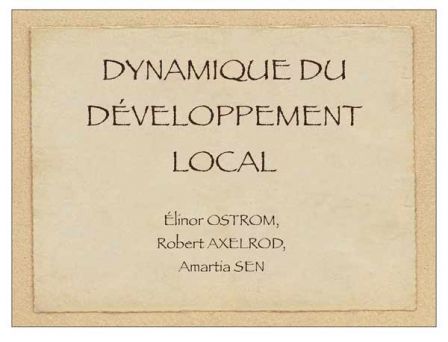Analyse
de :
La tragédie
des biens communs
Par Garrett
Hardin, 1968
Publié dans
Science, le 13 décembre 1968
L'auteur est
professeur de biologie, à l'Université de Californie, Santa Barbara. Cet
article est basé sur une intervention présentée avant la réunion de la Division
Pacifique de l'Association américaine pour l'avancement de la science à
l'Université d'État d'Utah, Logan, le 25 juin 1968.
Avertissement
(Bernard
GARRIGUES est docteur en géographie ; ses travaux de recherches portent
sur le développement local et l’économie alternative à l’économie
néolibérale : ce que Fernand BRAUDEL nommait l’économie de
rez-de-chaussée. Ce constat induit un corpus de préconceptions si connues
qu’inutiles à énoncer. À titre d’ayant-droit d’importants biens communs agricoles
de son village, il est (peut-être) le seul scientifique français à pouvoir
raisonner et écrire sciemment sur la réalité et la pratique de la mise en
valeur des biens communs.)
La connaissance de
l’article d’HARDIN arrive très tard dans mes recherches ; par la voix des
cadres de l’administration de l’État qui s’occupaient de développement local
lorsque nous leur parlions des biens des communautés villageoises. En pratique,
nous n’avons trouvé que de jeunes hauts fonctionnaires qui ne semblaient connaître
de cet article que le titre et avoir édifié, à partir de cette tragédie, qu’ils
imaginaient effroyable, la doxa du pire destin qui pouvait échoir aux biens
immeubles et aux ressources d’un système géographique local. Cependant, le
géographe observe un objet très robuste : le territoire, qui lui permet de
valider, ou non, toutes théories économiques. Frottés à la réalité du
territoire la théorie de la firme ou celle de l’entreprise publique montraient,
caricaturalement, leur faiblesse : (1) la première parce que la logique
d’une entreprise qui repose sur la création de valeur suffisante pour produire
indéfiniment des bénéfices plantureux soustraits au système créé ne résiste pas
à la réalité du long terme ; (2) la seconde parce qu’elle suppose, afin de
fonctionner a minima d’efficience, une information infiniment exhaustive de sa
gouvernance : situation hautement improbable. L’ignorance des jeunes hauts
fonctionnaires sur le fonctionnement des différents biens communs que les
collectivités villageoises exploitaient choquait un chercheur qui avait
participé, au jour le jour, à la maintenance optimale des biens communs de son
village par la collectivité des ayants-droit. Des résultats tombaient chaque
jour : les politiques de développement local produisaient du développement
local négatif et nous constations les gains exponentiels de la friche sur tous
les territoires ruraux. (1) L’obligation d’analyser rigoureusement les
processus de développement local
s’imposait à nous ; (2) puis, à partir de la validation suffisante
du « comment ça marche ? », le déblocage des freins conceptuels
et institutionnels devenait une priorité scientifique : l’article d’HARDIN
fait partie de ces blocages. Sa réfutation avait été entreprise presque
immédiatement aux E.U. mais n’avait pas beaucoup percolé en France ; la communauté
des chercheurs français (à quelques exceptions près[1])
devait l’apprendre en octobre 2009 lorsque le prix Nobel d’économie fut décerné
à Élinor OSTROM.
Introduction…
HARDIN fait, nous
semble-t-il, œuvre utile (1) en prenant acte que la croissance de la puissance militaire se fait au détriment de la
sécurité de la nation : cf. les dialogies d’Edgar MORIN ; (2) en
constatant qu’il existe un classe de « problèmes » (non
mathématiques) sans solution technique.
Y classer le « problème » de la population me paraît une
tentative osée pour deux raisons : (1) il existe une représentation
mathématique sommaire de la partie quantitative de ce problème ; (2)
l’évolution des populations aux E.U. et en Europe depuis le 18ème
siècle permet d’évaluer les variables structurantes lourdes de sa logique[2].
L’absence de définition, de délimitation et de critères de qualification entre
biens communs, biens publics et biens privés par HARDIN entraine une faiblesse
dans la rigueur de son article ; les travaux d’OSTROM reposent sur cette
qualification préalable.
Que devons-nous
maximiser ?
1/ L’essai
sur le principe de population de Thomas MALTHUS paraît en 1798 :
il est une réaction de type logique à une situation de misère populaire noire
consécutive à plusieurs années de mauvaises récoltes. Question : pour
quelles raisons l’apparente logique du partage des biens mondiaux limités entre
les membres d’une population de, admettons, 500 millions en 1798, a permis de
parvenir à 6 milliards en 1968 ? Sans trop d’accidents majeurs sensibles
dans le développement de la population mondiale.
2/ Si la
logique du raisonnement malthusien-hardinien est vérifiée, elle est applicable
aussi durement à une population de 6 milliards de rats, de 6 milliards de
cafards, de 6 milliards de peupliers d’Italie, etc... En pratique, le
raisonnement malthusien exige que soient définies les notions de biens et de
ressources qui la justifient, ainsi que l’unité de mesure. Personne ne me
contredira si j’affirme que le raisonnement de Thomas MALTHUS repose,
exclusivement, sur la quantité de nourriture disponible un jour j pour une
population p.
3/ Nous
pouvons égrener les variables multiples dont dépend la situation
« assez d’aliments un jour j pour une population p » : quantité,
qualité, stockage/conservation, prix/coût, transport.
4/ A
priori, l’utopie de Jeremy BENTHAM « le plus grand bien pour le plus
grand nombre » ne se limite pas à la nourriture.
5/ Rappelons
que les mathématiques sont une représentation limitée et choisie de la réalité,
pas la réalité. Il n’est nul besoin d’équations différentielles lorsque l’une
ou l’autre des variables est paramétrée : par exemple, le nombre de parts
dans un système géographique local. Plus, Henry POINCARÉ a proposé, au début du
20ème siècle, une représentation mathématique des systèmes à plus de
deux variables structurantes qui offre une solution politique : la
construction d’un attracteur du système. Certes la théorie mathématique du
chaos n’est ni d’un accès ni d’un emploi facile.
6/ Les
lois physiques de la thermodynamique. Il me semble indispensable (1) de
maîtriser a minima la thermodynamique afin de comprendre la comptabilité de
l’énergie des systèmes biologiques ; (2) puis de maîtriser la technique
comptable si nous voulons tirer des conclusions scientifiques du traitement de
l’énergie par les systèmes biologiques. Nous pouvons poser, a priori, qu’aucun
système : biologique, chimique, politique ou social, ne peut violer les
lois de la thermodynamique. La difficulté d’intégrer la consommation de
l’énergie fournie par l’alimentation dans le système global de l’énergie
mondiale provient (1) de l’absence de commune mesure entre les énergies misent
en œuvre aux différentes couches du système global ; (2) du constat
que la ponction énergétique sur les différents aliments est une donnée
conventionnelle statistique assez éloignée de la réalité, individu par individu
et environnement par environnement ; (3) de la faiblesse des rendements
énergétiques à tous les stades en raison des faibles différences de température
auxquelles ont lieu les ponctions énergétiques des systèmes biologiques (par
exemple) sur la ressource énergétique : 1 600 Calories (Cal) égale
1 860 Wattheure (Wh), soit un système d’une puissance de 77 Watt, soit une ampoule électrique
moyenne ; un kilogramme de pâtes alimentaires vaut 3 650 Cal, soit
4 184 Wh. En pratique, l’énergie effectivement utilisée par la vie est
sans commune mesure avec les flux d’énergie mis en œuvre par la nature, le travail
de l’homme ou reçus du soleil par la terre. Les plantes qui ont les meilleurs
rendements énergétiques : canne à sucre, jacinthe d’eau, luzerne,
n’atteignent pas 2% ; c’est-à-dire qu’elles consomment 100 watts d’énergie
lumineuse afin de stocker 2 watts d’énergie possiblement alimentaire. Au niveau
supérieur, celui des herbivores, un mouton doit transformer 12 Unités
Fourragères (environ 42 Kwh) pour produire 1 kg de viande (environ 4,5 kwh)
dont la valeur alimentaire tourne autour de 5 400 Cal.
7/ Il
est donc impossible de justifier le raisonnement de Garret HARDIN, dans ce cas
d’espèce, en ce qu’il concerne l’acquisition ou la dissipation de l’énergie.
Nous sommes dans un cas de figure où, pour la majorité de l’humanité, les
calories/travail mises en œuvre sont sans commune mesure avec les
calories/maintenance nécessaires à la vie : caricaturalement, l’énergie
déchargée en quelques millisecondes par un coup de fusil équivaut à plusieurs
mois de l’énergie captée dans les aliments afin de vivre. Nous pourrions commettre
la même observation pour toutes les activités humaines réclamant de l’énergie
brute.
8/ En
pratique, la notion de population optimale perd toute pertinence ; ou
plutôt dépend majoritairement de la logistique alimentaire déployée afin de
compléter correctement l’autoproduction individuelle.
9/ Reste
la notion de « bien », soulevée par BENTHAM, qu’HARDIN considère
comme un problème individuel parce que chacun attribue une valeur propre aux
différents éléments qui y participent. Le bien ne pourrait être partagé parce
que les biens sont incommensurables (nous admettrons l’inutilité de critiquer
que le bien soit composé d’une ensemble de biens). HARDIN propose que la
« sélection naturelle » soit le marqueur du bien de
BENTHAM ; ce qui dit qu’il existe
autant de « biens » que d’environnements. Le projet de BENTHAM paraît
beaucoup plus généraliste et politique. Dans la logique de HARDIN, il est
nécessaire de distinguer les biens qui ont besoin d’énergie pour exister ou
fonctionner (par exemple, les voitures automobiles) de ceux qui n’en ont pas
besoin (par exemple, les signes, dont les signes monétaires).
10/ Nous sommes
parvenus à un niveau scientifique qui nous permet de proposer un processus de
développement universel très simple : le processus intentionnel, chaque
élément de l’univers exécute à chaque instant ce qu’il préfère parmi ce qui est
possible ; le processus intentionnel n’est ni un processus aléatoire
ni un processus déterministe (par contre, il peut être qualifié de processus
exhaustif : tout ce qui est possible sera tenté). Un tel schéma ne permet
pas de définir à quel moment le choix des éléments de l’univers est devenu
conscient ; simplement d’affirmer que le développement a lieu sans être
gouverné par un projet politique rationnel.
11/ Nous (les scientifiques
et les politiques) devons différencier maintenant les processus de croissance
des processus de développement, rigoureusement. Je propose de qualifier
développement un processus qui améliore l’efficience d’un système à ressources
constantes (dont l’énergie) par complexification ; et de qualifier
croissance un processus qui exige une augmentation des ressources mises en
œuvre afin d’aboutir. Certainement
l’augmentation de la population doit être qualifiée de croissance ; mais
d’une croissance à faibles besoins énergétiques (ce qui n’est pas le cas de la
croissance du nombre de bulldozers). Comme le fait remarquer HARDIN, la
complexification de notre monde moderne porte évidemment sur le nombre de
variables structurantes des systèmes que nous habitons avec comme corollaire
que, au-delà de deux variables structurantes, nous ne savons pas en donner une
représentation mathématique facilement accessible. Nous admettrons, avec
HARDIN, que le système de population est un système complexe ; est-ce un
système en équilibre (autorégulé) ou instable ? Tous les historiques que
nous connaissons sur les systèmes de population tendent à montrer qu’ils sont
naturellement très stables et robustes ; même les accidents majeurs
(guerre, épidémie, invasion, migration, tremblement de terre, etc …) les
perturbent très peu à moyen terme. Nous avons vu qu’ils mettent en œuvre des
énergies relativement faibles par rapport aux énergies naturelles disponibles
sur le territoire ; or les accidents majeurs (par exemple, météorologiques)
correspondent à une dissipation brutale et immense d’énergie. En toute logique,
les systèmes de population ne disposent pas d’un stock d’énergie suffisant
capable d’engendrer une catastrophe perturbant son évolution.
12/ Nous pouvons
affirmer, sans aucun risque, qu’HARDIN pose un problème qui pèse si peu dans le
bilan énergétique de la machine terre qu’il ne vaut pas la peine d’être posé en
ces termes. Ni, a priori, d’y consacrer une génération de durs travaux
analytiques.
13/ Par contre, poser
le problème de la croissance de la population comme un problème d’épuisement de
ressources énergétiques shunte le problème du développement de cette population
qui, à mon avis, repose sur la maîtrise politique de deux variables : (1)
le capital social de cette population qui dépend, de façon importante, de son
accès facile à la connaissance (l’éducation) ; (2) la densité des
relations symétriques entre ses membres. Les travaux d’Emmanuel TODD montrent,
clairement, que la maîtrise de la croissance naturelle de la population est
complètement corrélée, en priorité, avec le niveau de formation des filles.
La tragédie de la
liberté d’utiliser un bien commun…
14/ Peu de
scientifiques ont eu mon privilège (1) d’entrer dans une collectivité
villageoise, créée au 11ème siècle, autour d’un bien commun[3] ;
(2) de disposer, à titre d’ayant-droit, de biens communs agricoles importants
exploités, par l’ensemble de la collectivité villageoise dans le respect des
intérêts familiaux de chacun ; exploités durant de longues années avant et
après que le pouvoir central se soit mis dans l’idée d’éradiquer ce mode de
propriété en le caractérisant de survivance anachronique. Aucun de mes voisins
ne peut comprendre le raisonnement d’HARDIN, tant il s’éloigne de ce qu’ils
vécurent tous les jours. Je me suis intéressé à nos biens communs pour
plusieurs raisons : (1) par curiosité intellectuelle et culturelle
d’abord ; (2) parce que je participais, comme habitant du village, à leur
mise en valeur et leur exploitation ; (3) enfin, lorsqu’il devint évident
qu’il s’agissait de droits mal défendus, je les ai étudiés, dans mes
recherches, comme marqueurs de la manière dont les pouvoirs local et central
respectaient le contrat social local. En particulier, depuis une ordonnance de
Charles IX en 1572, le pouvoir de l’État (le pouvoir royal, en l’occurrence)
s’est institué « protecteur des biens des communautés
villageoises » ; protection renouvelée en 1600 par Henry IV et en
1669 par Louis XIV. La loi de la Convention du 10 juin 1793 obéissait à la même
logique de l’État protecteur.
15/ La
thèse d’Élinor OSTROM réfute radicalement l’article d’HARDIN. Raisonner
rigoureusement sur les biens communs agricoles des collectivités villageoises
en Europe demande (1) de reconnaître leur origine comme résidu de l’appropriation
privée du territoire par les familles de la collectivité villageoise ; (2)
de se rappeler que la pratique « légale » des
« enclosures » en Angleterre fut, depuis l’origine, une violence
inimaginable à l’encontre des plus miséreux habitants du royaume durant
plusieurs siècles[4], disons
jusqu’en 1830.
16/ Je ne
contesterais pas la possibilité que des modes d’exploitation de biens communs
se soient mis en place aux E.U. suivant la logique décrite par HARDIN ; a
priori, il s’agirait de surfaces qui n’auraient été concédées à aucun
propriétaire privé et que l’autorité disposant du pouvoir de concession
mettrait à la disposition de l’ensemble des éleveurs d’un État ou d’un comté.
Remarquons qu’il ne paraît pas difficile pour le pouvoir administratif (1)
d’accorder des licences individuelles sur un pâturage précisément délimité avec
un chargement de bétail fixé sous peine de sanction ; (2) ou de confier à
un syndic, responsable sur ses propres biens, le pouvoir de faire respecter les
règles fixées par la convention de mise disposition. Sinon, il s’agit d’un
pouvoir incompétent : il ne devra s’en prendre qu’à lui d’avoir mis en
place un tel système qui ne pouvait que foirer et ne pas généraliser en
prétendant que l’esprit de lucre des éleveurs rend impossible une mise en
valeur un peu plus efficace des biens communs. Celui qui veut généraliser sur
la mise en valeur des biens communs doit rechercher les cas qui fonctionnent
depuis des siècles en cherchant à comprendre les raisons de cette durabilité.
De tels cas existent dans tous les pays du monde qui évoluèrent vers le
principe du droit de propriété, inviolable et sacré.
17/ Quant aux pays
qui n’instituèrent pas le droit de propriété privé, l’exploitation en commun du
territoire clanique, tribal ou villageois est la règle.
18/ Dans les pays
européens (Angleterre exceptée à partir du 16ème siècle), aucune
exploitation agricole familiale n’est « rentable » sans l’apport des
ressources des biens communs ; c’est dire que cette exploitation est
rigoureusement complémentaire de l’exploitation familiale. En pratique, un
ayant-droit ne peut mettre au troupeau conduit en commun un nombre de bêtes
supérieur à celui que l’exploitation familiale est capable d’hiverner ;
cette règle est hautement dissuasive dans la mesure où une surévaluation des
ressources de l’exploitation familiale aboutie à augmenter sa quotepart des
frais d’estivage et le risque de ne pouvoir assurer un hivernage correct de son
troupeau, facteur de dépréciation et de pertes de production. Pratiquement tous
les processus d’autorégulation imaginables furent mis en place par les
communautés villageoises qui gèrent des biens communs ; certains d’une
finesse incroyable comme, par exemple, les sanctions pour non-respect des
règles.
19/ Pour les systèmes
d’exploitation de biens communs qui perdurent depuis des siècles trois règles
de base émergent de la finesse, au plus près de la réalité journalière, de leur
gestion : (1) la définition et les limites exactes de la
ressource ; (2) les conditions strictes pour en être ayant-droit ;
(3) la gestion au jour le jour du consensus de gestion des biens communs par
leurs ayants-droit.
20/ HARDIN ne
qualifie pas du tout ce qu’il entend par le vocable de « biens
communs ». Du sens de l’article, il ressort qu’il s’agirait de tous les
ressources et biens dont le droit pratique anglo-saxon ne permet pas qu’ils
deviennent ou soient devenus « biens privés ». Dans la vieille
Europe, les biens communs (au moins ceux qui ont un propriétaire évident) sont
précisément définis par comparaison avec les biens privés, d’une part, et les
biens publics, d’autre part. OSTROM qualifie non seulement les biens communs
mais encore commet une analyse institutionnelle des difficultés de principes
posées par la gouvernance d’une entreprise privée : (1) l’objectif de la
sa gouvernance est clairement d’engendrer indéfiniment des bénéfices pour ses
dirigeants, donc un objectif logiquement inaccessible[5] ;
(2) la gouvernance des entreprises publiques repose sur l’a priori d’une
information parfaite de ses dirigeants en temps réel, donc un a priori
complètement irréaliste. Les biens communs sont ceux dont la propriété est
divisée entre ses ayants-droit (qu’OSTROM appelle « les
appropriateurs ») et la production partagée, équitablement, entre eux. Il
est clair que les exemples sur lesquels s’appuie HARDIN ne sont pas des biens
communs, pas un seul. Certains sont des biens publics, comme les parkings ou
les parcs nationaux ; d’autres des biens vacants, comme les pâturages dont
la propriété de la terre n’a pas fait l’objet d’une concession ; d’autres,
des abus individuels que l’autorité publique a oublié d’administrer, comme la
pollution ; enfin, le droit à reproduction des familles, dans aucune
société connue, ne fait partie des droits de propriété.
Pollution…
21/ Nous conviendrons
que le raisonnement d’HARDIN sur la pollution passe très bien en lui même mais
a peu à faire afin d’étayer un raisonnement sur les biens communs considérés
comme une modalité d’exercice du droit de propriété. Les Romains, à l’origine
de notre droit, considéraient « res nullius » les objets sur lesquels
nul n’avait de droit mais dont tous pouvaient disposer en les
« attrapant » ; de tels objets permettent d’en définir une autre
catégorie appelée par le droit romain « res communis » qu’aucun
individu ne peut s’approprier : nous pouvons penser que les éléments qui
constituent l’environnement font partie des « res communis » ;
ils justifieraient a posteriori la création de l’État par la communauté des
citoyens. Nous ne pouvons, en même temps, accepter un État et qu’il n’exécute
ce pourquoi nous l’avons créé. Il est aussi inacceptable de reconnaître la
ville comme un système hautement productif et, dans le même temps, que l’État
refuse de traiter les problèmes de pollution qu’elle engendre et pèsent sur la
productivité du système ville ; si la population des E.U. était répartie
assez égalitairement sur l’ensemble du territoire, aucun problème de pollution
ne viendrait troubler la sérénité d’un écologue US. Rappelons que l’Empire
romain fut victime d’un problème majeur d’intoxication de l’environnement par
le plomb, encore détectable dans les carottes extraites des glaciers du pôle
Nord : personne n’osera affirmer que la Terre, à l’époque de l’Empire
romain, supportait une population dont le nombre l’accablait.
Comment règlementer
la sobriété ?
22/ OSTROM,
politologue néo-institutionnelle, se devait de traiter la question de la
réglementation de la gouvernance des biens communs avec un soin
particulier. En rappelant l’adage
« Quis custodiet ipsos custodes » (Qui gardera nos gardiens ?)
HARDIN soulève une question à laquelle OSTROM répond avec élégance en ce qui
concerne la gouvernance des biens communs : tous les systèmes de biens
communs qui perdurèrent plusieurs siècles trouvèrent des moyens
d’autorégulation en temps presque réel des conflits entre ayants-droit afin
d’éviter la plupart des conflits radicaux. La défense des droits des
ayants-droit ne devra pas leur coûter plus cher que la valeur des droits
violés ; état de fait à peu près constant dans une société fortement
judiciarisée, aggravé par la complexité normale due au nombre d’intérêts qui
s’exercent dans la gouvernance de biens communs. Dans les systèmes de biens
communs la réponse à la question
que pose l’adage de HARDIN est évidente : tous les bénéficiaires de
biens communs en sont aussi les gardiens fonctionnels. Dans le cas des
aquifères californiens analysé par OSTROM, il a fallu que l’État californien
prenne en charge le coût de la démarche afin de finaliser les décisions des juges,
adopte une législation ad hoc et exécute les grands travaux nécessaires à la
reconstitution des aquifères et leur dessalement.
La liberté de se
multiplier est intolérable …
23/ Indépendamment de
la contestable approche énergétique de la maîtrise de la population, les
problèmes que sa croissance amène peuvent être traités de multiples façons, en
fonction des préconceptions politiques et sociales et des données disponibles
choisies : nous pouvons tous accepter l’idée que plus un problème est complexe,
plus il existe de solutions. Comme l’a montré Emmanuel TODD, quelles que soient
les préconceptions, la solution générale repose sur l’éducation et, d’abord,
sur l’éducation des petites filles : a priori, aucun développement n’est
possible si les habitants ne créent pas plus de richesses qu’ils ne consomment
de ressources ; quels que soient leur sexe, leur religion, leur race, leur
couleur de peau, leur niveau culturel ou social…
24/ Le deuxième
élément critique repose sur les travaux de Fernand BRAUDEL qui ont mis en
évidence les trois étages de l’économie : (1) l’économie de
rez-de-chaussée, dominée pendant longtemps par l’économie familiale ; (2)
l’économie du premier étage qui est celle des échanges ; (3) l’économie du
dernier étage, celle de la gouvernance. Prétendre que toute économie globale
repose sur la puissance de l’économie de rez-de-chaussée, donc sur le
fonctionnement de la famille, est loi d’être une grossièreté ; plutôt une
évidence. La représentation mathématique fractale du processus de développement
vient valider l’avis politique des Nations Unies.
La conscience est
autoéliminatrice…
25/ Depuis l’article
de HARDIN, s’est développée une réponse technique : les pilules
contraceptives, efficaces au gros du problème posé par HARDIN ; à
condition de vouloir bien abstraire les dérives financières auxquelles elles
donnent lieu. Ce qui rejette hors
jeu l’aspect métaphorique du jeu du morpion sur lequel HARDIN appuie son
raisonnement : certes le problème de la population est, globalement, sans
solution technique mais celui de la contraception, qui en fait partie de
manière lourde, a une solution à la fois élégante et efficace.
Les effets
pathogènes de la conscience…
26/ Il a existé des
civilisations brillantes sans notion de culpabilité du tout, reposant sur un
droit exclusivement civil, implicite, ou explicite à partir de Sumer. Les dieux
représentent des espèces d’animaux très puissants qu’il vaut mieux ne pas
contrarier ; pas des gardiens d’une morale qui n’existe pas. Proposons de
dater le début de la morale dans le décalogue des Hébreux. La double
contrainte, modèle Bateson, ne peut exister dans une société réelle (1) sans une
morale largement dominante ; (2) sans une morale avec sanction sociale suffisamment
automatique. Remarquons impensable la morale du décalogue sans (1) la croyance
en un dieu unique tout puissant et tout sachant ; (2) une société à forte
identité aux limites strictes et robustes.
27/ La double
contrainte sans conscience existe dans tous les domaines du développement
depuis le big-bang. Je l’exprime d’une manière simpliste mais difficilement
réfutable : chaque élément de l’univers commet à chaque instant (1)
n’importe quoi (2) parmi tous les possibles. Par exemple, dans un système
physique, ce sont les variables température et pression qui établissent le
champ du possible ; nul besoin de conscience. Une telle définition admet
comme corollaire que chaque franchissement d’un palier de complexité augmente
le champ du possible.
28/ Enfin, les
travaux de Noam CHOMSKY montre clairement que le gros de la gouvernance des
sociétés humaines repose sur la manipulation de l’opinion publique par des
techniques tout à fait au point qui furent systématiquement formalisées par
l’idéologie nazie dans les années 1930.
29/ Cependant,
l’effet de la notion de culpabilité sur les membres d’un réseau social de
proximité un peu cohérent n’est pas anodin comme le met en évidence l’article
d’HARDIN ; il peut conduire au suicide. Cela n’a rien à voir avec la
gouvernance des biens communs telle qu’elle a été imposée par la représentation
nationale égarée en 1985 ; les suicides des paysans victimes de la loi,
indépendamment du fait que le monde agricole est, historiquement, la population
la plus suicidaire du pays, doivent être plutôt imputés aux spoliations « au
nom de la loi » des ayants-droit qui en résultèrent qu’à un hypothétique
sentiment de culpabilité insupportable.
Contrainte
consensuelle…
30/ L’idée de la
contrainte consensuelle paraît bien partagée dans toute société a minima
démocratique : elle aboutit pratiquement au contrat civil équilibré ;
le juge, le cas échéant, régule l’équilibre du contrat. La gouvernance
politique n’est pas un contrat équilibré puisqu’elle repose, lourdement, sur
les prérogatives de puissance publique ; même si diriger sans consensus
majoritaire ne peut perdurer très longtemps.
31/ Je propose de
définir les biens communs comme (1) des biens (ou une ressource) strictement
délimités (2) dont les ayants-droit sont strictement qualifiés (3) unis par un
contrat civil explicite (4) dont ils assurent la maintenance eux-mêmes au plus
près du temps réel. Ces quatre conditions permettent de trier les biens
communs, non seulement des biens publics et de biens privés, mais aussi des
biens, possiblement privés, publics ou communs, non encore appropriés.
32/ Il me semble
judicieux de charger l’État de la gouvernance de biens publics, assise sur le
principe de base l’intérêt public. Et que cet État laisse les propriétaires de
biens privés les gérer eux-mêmes ; ainsi que les ayants-droit de biens
communs les gérer aux mieux des intérêts de leur collectivité ; le tout à
leurs risques et périls.
33/ Les moyens de
contrainte (prérogatives de puissance publique) dont dispose l’État ne peuvent
être qualifiés de consensuels ; sauf par ceux qui détiennent le pouvoir
d’en user, voire d’en abuser ou d’en recueillir les fruits. La situation
actuelle du contrat social national, dans toutes les nations du bloc
démocratique occidental, fait (1) que le pouvoir exécutif a échappé au contrôle
des citoyens (2) que, lorsqu’un membre du pouvoir législatif, voire n’importe
quel homme politique, argue d’intérêt public pour une action précise, il attise
la méfiance de la plupart des citoyens qui demandent à connaître le prénom de
l’intérêt public.
34/ Je ne peux concevoir la
notion de suppression d’un bien commun correctement défini ; seulement
interdire son accès ou le transférer à un propriétaire privé ou à un
propriétaire public. En tout état de cause, qu’il s’agisse d’une ressource ou
d’un immeuble, le bien commun perdure et les comptes du système dont il fait
partie, explicitement ou non, persistent à venir en plus ou en moins. Pour
réutiliser le raisonnement énergétique à l’origine de l’article d’HARDIN, même
si nous ignorons la tenue des comptes énergétiques des individus, des
collectivités et des États, il n’empêche que l’énergie dégradée disparaît de
l’actif des ressources mondiales.
Reconnaissance de
la nécessité…
35/ Aucun argument ne
permet de qualifier la population ou le droit de se reproduire comme un bien
commun, ni même comme une ressource commune. Quant à l’ensemble des ressources
naturelles, leur qualification de bien commun disparaît au fur et à mesure de
leur appropriation publique ou privée ; processus fortement corrélé à
l’augmentation de la population, comme l’indique HARDIN.
36/ Les contrôles
forcés (comme en Chine), criminels (comme aux Indes), ou idéologiques (comme en
Allemagne hitlérienne) de la population ou de certaines populations aboutirent
toujours à des catastrophes sociales irrépressibles.
37/ L’analogie avec
les techniques d’élevage des animaux par les hommes montre qu’il existe un
processus naturel de contrôle, non pas des populations, mais de la densité
acceptable sur un territoire donné
entre individus d’une même espèce qui puisse éviter l’apparition, puis
la diffusion de maladies radicales. Pour l’élevage ovin (dont je suis un
spécialiste estampillé) les problèmes sanitaires commencent lorsque la densité
d’animaux dépasse la moitié du potentiel théorique du pâturage sur un cycle
(environ 8 mois) ; ce qui dit aussi que l’art de la conduite d’un
troupeau consiste à éviter les surdensités momentanées dans le temps et
l’espace : il s’agit d’un constat d’expérience. Les éleveurs en haute
promiscuité maîtrisent (apparemment) le cycle de production par un mix
d’antibiotiques, d’antiparasitaires dans l’alimentation et de produits
désinfectants dans les batteries d’élevage.
38/ Les villes
constituent des terrains extrêmement favorables à la diffusion (mais aussi
l’apparition) des maladies radicales. Nous avons tous entendu parler des armes
bactériologiques mais pas vraiment de décisions politiques afin d’inoculation
de maladie qui viserait à « éradiquer » une catégorie précise de
citoyen ; telle la myxomatose, les lapins. Cependant, au 19ème
siècle en France, l’impôt sur les portes et les fenêtres a eu comme résultat
(involontaire) la diffusion endémique de la tuberculose. Il existe aussi
quelques cas douteux de diffusion de maladies par imprudence dont, avec
quelques probabilités, le SIDA.
39/ Pour le moment,
le processus le plus efficace connu afin de contrôler la croissance d’une
population est le couple misère + alcool à bas prix (exemple des républiques
soviétiques après l’effondrement de l’URSS, mais aussi des populations autochtones
amérindiennes). Probablement, la diffusion importante de drogues aurait un
effet identique. Remarquons que de tels processus exploitent les faiblesses de
l’homme ; pas son potentiel reproducteur ou ses dons à la culpabilité.
40/ Accepter la
contrainte de la nécessité
comporte plusieurs aspects : (1) il ne peut s’agir d’une règle
constitutionnelle générale à inscrire dans les principes généraux d’un droit
universel ; (2) la nécessité comporte un jugement de valeur négatif propre
à l’individu qui la prononce ; (3) comment cela fonctionne-t-il en
logique structuraliste[6] ?
(4) peut-on donner une
représentation fractale de sa diffusion ? Même en invoquant HEGEL, il ne
sera pas facile de démontrer que « la liberté est la reconnaissance de la
nécessitée » ; poussé à l’extrême, un tel principe aboutirait à
admettre la prison comme le lieu ultime de liberté. Remarquons qu’en remplaçant
« liberté » par « fraternité » ou « égalité »
nous parvenons à des propositions ayant à peu près la même puissance de
conviction.
(41) L’exploration du
champ du possible apparaît à la fois plus rigoureux, délimité nettement (a
posteriori), ouvrir en grand la porte de la créativité, une conception
autorégulée, sans jugement de valeur. La complexification tendancielle de notre
monde dégage et agrandit presque à l’infini le champ du possible ; donc le
potentiel développement des
sociétés humaines. Elle donne accès à de nouveaux biens communs comme la mise
en réseau internet de collectivités villageoises ou de quartier ; d’une
façon moins évidente, aussi aux collectivités thématiques en temps réel. Il
devient possible d’imaginer, sous forme de biens communs, des bases de données
qui mutualisent les savoirs de leurs ayants-droit, les connaissances stockées
en leurs gènes, etc …
(42) Les problèmes complexes
rendent difficiles l’accès à une solution mais aussi, en contrepartie, plus ils
sont complexes plus ils peuvent recevoir des solutions. Lorsqu’un scientifique
ou un homme politique peuvent dire : « J’ai analysé et compris cet
immense et complexe problème, et j’ai ai trouvé la seule solution qui vaille. », tout le monde peut
répondre, soit le problème est simple et sa solution évidente et accessible à
tous, soit le problème est sûrement complexe et il accepte de nombreuses
solutions. En ce qui concerne la gouvernance de biens communs, nous admettrons
facilement qu’il s’agit d’un problème complexe mais aussi que les hommes depuis
des dizaines de siècles qu’ils exploitent des biens communs (certaines
civilisations ne connaissent que les biens communs) ont exploré et essayé la
majorité du possible en la matière (manque les nouvelles possibilités que nous
ouvrent l’économie du savoir et ses outils). Il faut puiser dans ces
expériences ; elles n’ont rien de tragique ; elles ouvrent un nouveau
cycle de développement, infini.
RÉFÉRENCES GARRET
HARDIN
1. J.
B. Wiesner and H. F. York, Sci. Amer. 211 (No. 4). 27 (1964).
2. G.
Hardin, J. Hered. 50, 68 (1959); S. von Hoernor, Science 137, 18
(1962).
3. J.
von Neumann and O. Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior (Princeton
Univ. Press, Princeton, N.J., 1947), p. 11.
4. .
H. Fremlin. New Sci., No. 415 (1964), p. 285.
5. A.
Smith, The Wealth of Nations (Modern Library, New York, 1937), p. 423.
6. W.
F. Lloyd, Two Lectures on the Checks to Population (Oxford Univ. Press,
Oxford, England, 1833), reprinted (in part) in Population, Evolution, and
Birth Control, G. Hardin. Ed. (Freeman, San Francisco, 1964), p. 37.
7. A.
N. Whitehead, Science and the Modern World (Mentor, New York, 1948), p.
17.
8. G.
Hardin, Ed. Population, Evolution. and Birth Control (Freeman, San
Francisco, 1964). p. 56.
9. S.
McVay, Sci. Amer. 216 (No. 8), 13 (1966).
10. J.
Fletcher, Situation Ethics (Westminster, Philadelphia, 1966).
11. D. Lack,
The Natural Regulation of Animal Numbers (Clarendon Press, Oxford,
1954).
12. H. Girvetz,
From Wealth to Welfare (Stanford Univ. Press. Stanford, Calif., 1950).
13. G. Hardin, Perspec.
Biol. Med. 6, 366 (1963).
14. U. Thant,
Int. Planned Parenthood News, No.168 (February 1968), p. 3.
15. K. Davis, Science
158, 730 (1967).
16. S. Tax,
Ed., Evolution after Darwin (Univ. of Chicago Press, Chicago, 1960),
vol. 2, p. 469.
17. G. Bateson,
D. D. Jackson, J. Haley, J. Weakland, Behav. Sci. 1. 251 (1956).
18. P. Goodman,
New York Rev. Books 10(8), 22 (23 May 1968).
19. A. Comfort,
The Anxiety Makers (Nelson, London, 1967).
20. C. Frankel,
The Case for Modern Man (Harper, New York, 1955), p. 203.
21. J. D.
Roslansky, Genetics and the Future of Man (Appleton-Century-Crofts, New
York, 1966). p. 177.